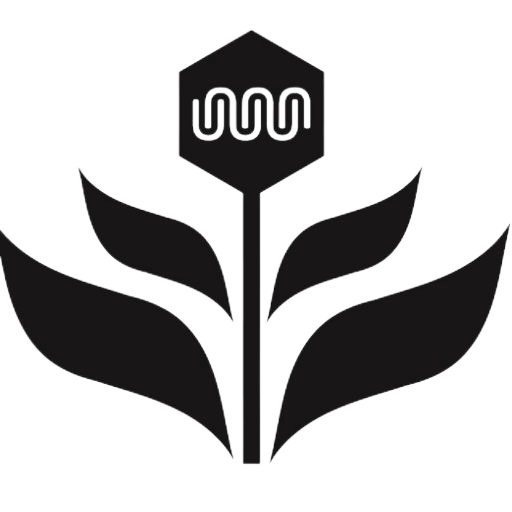Le dérèglement climatique résulte essentiellement des émissions de dioxyde de carbone. Pour le résoudre, ne suffirait-il pas de capter ce carbone excédentaire, puis de le stocker ? C’est l’idée derrière un des grands thèmes de l’innovation écologique: la capture de carbone et son usage ou stockage. Dans ce dossier, nous allons vous présenter les différentes technologies et leur intérêt:
- Partie 1: Les techniques de capture de carbone
- Partie 2: Le stockage du carbone
- Partie 3: Les usages du carbone
- Partie 4: Les différentes approches globales
- Partie 5: Le déploiement de la CCUS
Notez un point de vocabulaire: « CCUS » désigne le procédé en sortie de cheminée d’usine ou de centrale (= il s’agit d’empêcher une émission de CO2), alors que CDR (Carbon dioxide removal) consiste à retirer du carbone déjà présent dans l’atmosphère. Néanmoins, pour la démonstration, j’englobe ces deux ensembles dans le terme « CCUS », le terme « capture » étant assez large pour désigner les deux démarches.
Partie 1: Les techniques de capture de carbone
On peut répartir les techniques de capture de carbone en 3 grands ensembles: la capture organique (photosynthèse), la capture en sortie de cheminée d’usine ou de centrale et la captation directe dans l’air (DAC, Direct Air Capture).
La capture organique du carbone
C’est le mode de capture du carbone le plus ordinaire: la photosynthèse. Les plantes vertes captent la lumière du soleil, de l’eau et le CO2 de l’air et les transforment en du glucose pour la plante. C’est le domaine de l’agriculture, notamment de la foresterie et de l’agriculture de conservation des sols, et des formes innovantes de culture (de micro algues notamment) de la chimie verte.
La capture de carbone « classique »: en sortie de cheminée
Lorsqu’on parle de capture de carbone ou « CCUS », c’est à la technologie en sortie de cheminée qu’on fait souvent référence: la capture de carbone en sortie d’usine ou de centrale. C’est ce qui permettrait de rendre bas carbone la combustion de carburants fossiles, comme avec « l’hydrogène bleu » (= produit par gazéification ou vaporéformage + CCUS) par exemple. La technologie traditionnelle s’appelle captation carbone « post-combustion« . C’est une pratique courante dans certaines industries, pour limiter en cas de besoin la quantité de CO2 rejetée.
D’autres technologies, se faisant aussi après la combustion, sont développées, comme l’oxycombustion, la combustion se fait en présence d’oxygène pur, ce qui permet de produire une fumée beaucoup plus concentrée en CO2 (il n’ y a pas l’azote), ce qui facilite le filtrage.
Certains évoquent une captation carbone « pré-combustion », consistant à transformer le combustible en gaz de synthèse par gazéification, puis d’en récupérer le carbone, ne gardant ainsi que l’hydrogène. Néanmoins, ce n’est ni plus ni moins que de production d’hydrogène, je ne le classe dont pas parmi les présentes technologies, d’autant plus qu’elle ne semble pas viable.
Notez que cette technologie peut aussi permettre une technologie de retrait de carbone (Carbon Dioxyde Removal): la BECCS (Bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone). En effet, il s’agit de capter et stocker le CO2 provenant de la combustion de biomasse. Ainsi le carbone est d’abord stocké par la biomasse (l’arbre en général), puis capté lors de la combustion. On a bien une opération « carbone négative ».
La capture directe dans l’air (DAC, Direct Air Capture)
Une solution populaire est d’extraire le carbone de l’air ambiant. On parle de capture directe (du carbone) dans l’air: DAC (Direct Air Capture). Le procédé est beaucoup moins efficient (le prix est plusieurs fois plus élevée à la tonne captée) que la captation en sortie d’usine, mais elle est aussi plus flexible, pouvant notamment se placer près d’une installation utilisant le CO2 capté ou étant capable de le stocker. Cela permet aussi de compenser des émissions de carbone trop difficiles à éviter.

Partie 2: Le stockage du carbone
Une fois le carbone capté, il faut encore le stocker. Il y a plusieurs pistes pour cela. La plus connue est le stockage sous forme gazeuse, notamment dans des cavité souterraines. Toutefois, il y a d’autres méthodes: le stockage dans les solides, par exemples dans du ciment ou dans les arbres; le stockage dans l’océan par précipitation et le stockage dans les sols.
Le stockage gazeux
Le principal problème du gaz est qu’il prend beaucoup de place et qu’il s’échappe facilement. Une piste intéressante est son stockage géologique. Il y en a trois types:
- Les cavités salines
- Les réserves d’hydrocarbures
- Les aquifères
Évidemment, dans le cas de stockage temporaire (ex: en attendant un transport pour être ensuite utilisé ou stocké ailleurs), il faudra recourir à des réservoirs classiques.
Le stockage dans les solides
Le carbone est un des éléments fondamentaux de la vie, il est présent dans de nombreux matériaux. L’idée est de stocker le carbone dans ces solides. C’est évidemment la logique derrière la foresterie (on enferme le carbone dans le bois), mais aussi pour les cultures en général (même si en général c’est une logique plus éphémère). Surtout, il y a de plus en plus de méthodes pour enfermer le CO2 dans des matériaux lors de procédés industriels, comme la conception de ciment.
Le stockage dans l’eau
Les océans emmagasinent une quantité de carbone dix fois supérieure à celle de l’atmosphère et absorbent un quart des émissions humaines chaque année. Cela passe par deux processus naturels : le cycle du carbone solubilisé et le cycle biologique. L’idée du stockage océanique du CO2 est de mettre à profit ces mécanismes pour capter plus de CO2 grâce à l’océan. Des méthodes innovantes émergent, telle la fertilisation des océans, le stockage géologique sous-marin, l’alcalinisation, l’injection de CO2 en profondeur ou l’emploi de carboglaces. Toutefois, ces stratégies ne sont pas exemptes de complexité. Elles portent en elles des risques environnementaux potentiels, des efficacités de stockage variables et des enjeux de gestion non négligeables. En outre, leur mise en œuvre est parsemée de défis logistiques et financiers conséquents.
Le stockage du carbone dans les sols
L’agriculture peut stocker le carbone dans les sols. C’est l’un des axes de l’agriculture de conservation des sols et de l’initiative 4 pour 1000.
Partie 3: Les usages du carbone
« In order to reach net zero CO2 emissions for the carbon needed in society (e.g., plastics, wood, aviation fuels, solvents, etc.), it is important to close the use loops for carbon and carbon dioxide through increased circularity with mechanical and chemical recycling, more efficient use of biomass feedstock with addition of low-GHG hydrogen to increase product yields (e.g., for biomethane and methanol), and potentially direct air capture of CO2 as a new carbon source
GIEC, vol.III, Technical Summary, p.106 : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_TechnicalSummary.pdf
Stocker le carbone est une charge: ne pourrait-on pas en faire un profit en l’utilisant comme une ressource ? C’est la piste approfondie par de nouveaux usages du bois, dans la construction, mais aussi par la chimie verte et autres nouveaux procédés industriels. Déjà aujourd’hui, autour de 230 Mt de CO2 sont utilisés chaque année, essentiellement pour la production d’urée (125 Mt/an) et pour l’EOR de l’oil&gas (70 – 80Mt). Il y a également d’autres usages, mais peu signifiants, notamment dans l’alimentaire, le refroidissement, le traitement de l’eau et les serres. (IEA 2020)
La chimie verte
Le CO2 peut être utilisé dans la production de plusieurs produits chimiques:
- L’urée. C’est une technologie déjà mature. (TRL 11)
- Le ciment. On peut en effet utiliser le CO2 en remplacement de l’eau dans la conception de béton (on parle de « CO2 curing ») et comme matériau de base dans le ciment. Ce sont des technologies en cours d’adoption. (TRL 9-10)
- Le méthanol. C’est une technologie en cours de démonstration. (TRL 7-8)
- Le méthane de synthèse (e-methane) C’est une technologie en cours de démonstration. (TRL 7-8)
- Les carburants liquides de synthèse (e-fuels): C’est une technologie en cours de prototypage (TRL 5-6).
Déjà aujourd’hui, l’installation George Olah, en Islande, transforme chaque année 5 600 tCO2 et de l’hydrogène vert en méthanol.
Développer la construction en bois
La construction est actuellement l’un des principaux émetteurs de gaz à effets de serre, notamment à cause de l’utilisation de ciment, un outil fantastique dont la conception émet énormément de CO2.
Il y a d’autres usages du bois, comme pour les jouets, mais ils me semble infinitésimaux et peu viables (ils ne remplacent pas efficacement leurs alternatives).
La biomasse – énergie
En parlant CCUS, on est forcé de parler de l’utilisation de biomasse pour l’énergie, comme le bois ou le e-methane. Selon l’IAE, plus de 90% du carbone destiné à être utilisé ( 10% du total, le reste serait stocké) le sera pour faire des carburants de synthèse, notamment pour les avions. Néanmoins, cela sort de la logique du stockage de carbone pour une logique d’énergie renouvelable. Je vous renvoie aux pages dédiées : [biocarburants] [bois-énergie].
Nouveaux procédés industriels incorporant le carbone
On peut distinguer l’usage du carbone de son stockage dans les matières en regardant si l’utilisation du carbone apporte une vraie valeur ajoutée comparable à son coût. Le meilleur exemple d’usage du carbone est la construction en bois … en général. S’efforcer coute que coute de faire un bâtiment en bois pourra être davantage une logique de stockage.
Parmi les exemples de procédés industriels utilisant du CO2, Covestro en Allemagne produit à Dormagen 5000t de polymère par an, dans lesquels le CO2 est utilisé.
Partie 4: Les différentes approches globales
Je vous ai présenté les différents aspects de la CCUS. Néanmoins, en pratique, on va plutôt distinguer par type d’approche:
| Approche | Maturité | Potentiel de captation carbone (cumul jusque 2100, GtCO2)* | Prix de la capture CO2 (USD/tCO2) |
|---|---|---|---|
| Bioenergie avec CCS | Démonstration | 100-1170 | 15-85 |
| Direct Air Capture et Stockage | Démonstration | 108-1000 | 135-345 |
| Enhanced weathering of minerals | Recherche fondamentale | 100-367 | 50-200 |
| Gestion des sols (« land management » ?) et production de biochar | Début d’adoption | 78-1468 | 30-120 |
| Fertilisation/alkalinisation des océans | Recherche fondamentale | 55-1027 | – |
| Afforestation/reforestation | Début d’adoption | 80-260 | 5-50 |
Partie 5: Le déploiement de la CCUS
Outre la foresterie, la CCUS post-combustion est pratiquée depuis plusieurs dizaines d’années, notamment dans l’oil&gas pour l’EOR (Enhanced Oil Recovery), qui consiste à envoyer du CO2 dans les puis de pétrole, pour en extraire le plus possible. Une large part du CO2 reste ensuite dedans.
Notez que l’IEA avait déjà, en 2009, fait une roadmap proposant d’atteindre une capacité de stockage de 300 MtCO2 par an en 2020. Néanmoins, elle n’était alors que de 40Mt. Cela peut s’expliquer par le manque de consistance des politiques publiques et, surtout, l’absence de prix suffisant sur l’émission de CO2. (IEA 2020)
La CCUS « classique », post combustion: une partie de l’oil&gas
La CCUS « classique », c’est-à-dire post-combustion, utilisant les fumées émanant de processus industriels dès leur sortie, est pratiquée depuis plusieurs dizaines d’années en combinaison avec l’oil&gas. En effet, on injecte le CO2 dans le réservoir d’hydrocarbure pour pousser vers la surface le plus de pétrole possible: on appelle cela l’EOR, Enhances Oil Recovery. L’essentiel du CO2 ainsi injecté reste emprisonné dans le gisement (à vérifier).
Cette technologie permettrait de rendre moins carbonées des centrales à énergies fossiles. En effet, une large part de ces dernières ont été construites récemment et les décommissionner représente un surcoût considérable. Leur ajouter de la CCUS permettrait de limiter leur impact à un prix plus raisonnable. Elle permet également de diminuer les émissions de certaines industries très difficiles à décarboner, comme le ciment.
Une CCUS naissance : la DAC
La captation directe de carbone est de plus en plus populaire, gagnant une traction significative à partir de 2019.
- IEA (2020), CCUS in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions, License: CC BY 4.0